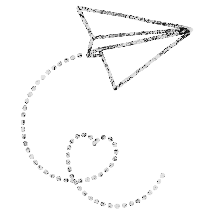Marchés grouillants, échoppes colorées, vendeurs ambulants, artisans discrets, transporteurs débrouillards… Le secteur informel est omniprésent à Madagascar, tissant la trame quotidienne de la vie économique et sociale pour une immense majorité de la population. Bien plus qu’une simple marge, il constitue un pan colossal de l’économie nationale, représentant, selon les estimations récentes (FTHM Consulting/BAD/MEF 2022), entre 26% et 29% du Produit Intérieur Brut et, surtout, la source principale d’emploi et de revenus pour plus de 90% des unités économiques et de la population active. Cette réalité massive pose un dilemme stratégique fondamental pour la Grande Île : cet océan d’activités non déclarées est-il une force vive, un moteur de résilience indispensable à la survie de millions de Malgaches, ou constitue-t-il une ancre freinant le développement structurel, la productivité et la capacité d’investissement de l’État ?
Un Colosse Économique aux Multiples Visages
Avec environ 3 millions d’entreprises informelles recensées, ce secteur est loin d’être monolithique. Il englobe une vaste gamme d’activités, allant de l’agriculture de subsistance (qui occupe une part très importante de la main-d’œuvre) au petit commerce de détail omniprésent en milieu urbain, en passant par les services (transport, réparation, restauration), l’artisanat traditionnel et la petite transformation. La caractéristique commune est l’absence d’enregistrement officiel (numéro statistique, registre de commerce) et le non-respect d’une partie ou de la totalité des réglementations (fiscales, sociales, laborieuses).
Les acteurs de cet univers sont majoritairement des micro-entrepreneurs individuels ou des entreprises familiales de très petite taille (taille moyenne souvent inférieure à 2 emplois). L’auto-emploi y est la norme. Si les hommes y sont statistiquement majoritaires globalement, les femmes jouent un rôle prépondérant dans certains segments, notamment le commerce et les services non agricoles. Le niveau d’éducation formelle y est souvent bas, en particulier en milieu rural, et beaucoup y entrent faute d’alternative dans le secteur formel.
L’Indispensable Filet de Sécurité Sociale… Informel
La prédominance écrasante de l’informel à Madagascar s’explique largement par un contexte économique et social difficile : pauvreté persistante (plus de 80% de la population vivant sous le seuil de pauvreté international), chômage et sous-emploi élevés dans le secteur formel, accès limité à l’éducation et au capital. Dans ces conditions, l’économie informelle agit comme une immense soupape de sécurité, une « bouée de sauvetage » pour des millions de personnes.
Sa grande flexibilité, les faibles barrières à l’entrée (peu de capital ou de qualifications formelles requis pour démarrer une petite activité), et sa capacité à répondre rapidement aux besoins locaux de biens et services essentiels en font le principal pourvoyeur de moyens de subsistance. Il absorbe une main-d’œuvre que le secteur formel ne peut intégrer et constitue souvent la première, voire l’unique, source de revenus pour les ménages les plus vulnérables.
Le Lourd Tribut de l’Ombre sur le Développement National
Si sa fonction de survie est indéniable, l’omniprésence de l’informel génère des externalités négatives majeures qui pèsent lourdement sur les perspectives de développement à long terme de Madagascar :
- Érosion Fiscale et Faiblesse de l’État : Échappant en grande partie à l’impôt et aux cotisations sociales, le secteur informel prive l’État de recettes fiscales considérables. Ce manque à gagner limite drastiquement sa capacité à financer les infrastructures essentielles (routes, énergie, eau), les services publics fondamentaux (santé, éducation) et les programmes de développement visant à réduire la pauvreté structurelle.
- Piège de la Faible Productivité : Caractérisées par un faible niveau d’investissement, un accès quasi inexistant au financement formel, l’utilisation de technologies souvent rudimentaires et des pratiques de gestion peu élaborées, les unités informelles ont généralement une productivité faible. Cela freine la croissance économique globale, l’innovation et la montée en gamme de l’économie malgache.
- Vulnérabilité et Absence de Droits : Les travailleurs de l’informel sont les grands oubliés de la protection sociale. Sans contrat de travail formel, ils ne bénéficient généralement pas de couverture santé, d’assurance accident, de droits à la retraite ou d’allocations chômage, les exposant de plein fouet aux aléas de la vie (maladie, accident, vieillesse). Cette précarité renforce les inégalités et enferme souvent les individus dans des cycles de pauvreté.
- Concurrence et Fragmentation : L’informalité peut créer une concurrence jugée déloyale par les entreprises formelles (qui supportent charges et réglementations) et complexifie l’application des normes (travail, environnement, qualité).
Entre Formalisation et Accompagnement, Quelle Voie pour Madagascar ?
Face à cette réalité complexe, les politiques publiques oscillent souvent entre la tentation de la formalisation à marche forcée (pour récupérer des recettes fiscales et réguler) et un certain laisser-faire pragmatique. Or, aucune de ces approches extrêmes n’est satisfaisante. Une formalisation brutale risque de détruire des moyens de subsistance fragiles sans offrir d’alternative viable, compte tenu des coûts et de la complexité des procédures souvent mal comprises ou jugées peu pertinentes par les acteurs eux-mêmes.
Les experts et les organisations internationales (comme l’OIT) plaident de plus en plus pour des stratégies nuancées et progressives, adaptées à l’hétérogénéité du secteur :
- Simplification radicale : Rendre les procédures d’enregistrement et de déclaration fiscale/sociale beaucoup plus simples, accessibles et moins coûteuses pour les micro-entreprises.
- Incitations positives : Lier la formalisation à des avantages concrets (accès facilité au micro-crédit, à des formations, à des marchés publics, à une protection sociale minimale).
- Amélioration dans l’informel : Reconnaître que tout ne sera pas formalisé à court terme et chercher à améliorer les conditions de travail, la sécurité et la productivité au sein même du secteur informel (formation professionnelle ciblée, appui à l’organisation – coopératives, associations, extension progressive de filets de sécurité sociale).
- Approche segmentée : Différencier les politiques selon les types d’activités ( distinguer les activités de pure survie de celles ayant un potentiel de croissance).
Intégrer Sans Étrangler, le Défi d’une Croissance Inclusive
Le secteur informel malgache n’est ni une fatalité à subir, ni un ennemi à combattre frontalement. C’est une composante structurelle de l’économie, expression de la résilience et de la créativité de la population face aux contraintes. L’enjeu stratégique pour Madagascar est de concevoir et mettre en œuvre des politiques intelligentes qui parviennent à intégrer progressivement ce secteur dans un cercle vertueux de développement, sans pour autant « étrangler » sa fonction vitale de pourvoyeur d’emplois et de revenus pour la majorité.
Cela exige une compréhension fine de ses dynamiques, un dialogue constant avec ses acteurs, et une vision à long terme visant à améliorer la productivité, étendre la protection sociale, et renforcer la capacité fiscale de l’État de manière équitable et incitative. Bâtir des ponts solides entre l’économie informelle et l’économie formelle, en reconnaissant leurs interdépendances et en facilitant les transitions volontaires, est sans doute l’un des défis les plus complexes mais aussi les plus cruciaux pour l’avenir économique et social de la Grande Île.